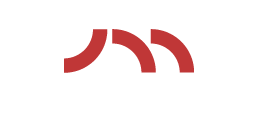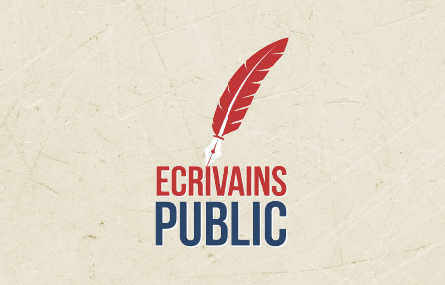Texte issu d'un courrier envoyé par Manel Maarif, étudiant partenaire du dispositif, à Guillaume Noll, directeur des services de greffe judiciaires au Tribunal Judiciaire de Lyon
Je croyais devoir prêter ma plume. Mais il m’a fallu prêter l’oreille, le cœur, et parfois même un peu de moi-même pour traduire des histoires que les mots ne suffisent pas toujours à dire. S’il m’a fallu du temps pour appréhender les contours d’un rôle aussi singulier, c’est qu’il ne se laisse pas saisir par un formulaire. Pourtant, très vite, ces conditions nouvelles sont devenues familières. J’ai trouvé mes repères entre une permanence partagée avec un binôme solidaire, un bureau ouvert qui favorisait l’entraide mutuelle, et cette machine de numérisation récemment installée, simple d’usage, mais si précieuse pour fluidifier nos démarches.
Au début, il était difficile de respecter l’heure de fin, 17h arrivant souvent trop tôt. Apprendre à refuser – avec tact — une demande en fin de journée, a été un apprentissage difficile mais nécessaire. J’ai compris que rendre service, c’est aussi savoir poser des limites sans perdre l’humanité du geste.
Le public rencontré m’a bouleversée. Beaucoup venaient avec le sentiment que nous étions leur dernier recours. Certains apportaient des dossiers ; d’autres portaient surtout le poids d’un récit et d’une détresse. Il m’a fallu écouter sans vaciller, accueillir sans absorber. Une dame m’a particulièrement marquée : mariée depuis quarante ans, récemment divorcée d’un homme qui avait confisqué ses droits – allant jusqu’à lui interdire l’accès à la boîte aux lettres, usurper son identité, signer à sa place. Elle découvrait le monde administratif comme on débarque sur une terre étrangère. Mon rôle, ici, n’était pas seulement procédural : c’était de lui restituer un peu de contrôle, de dignité. Il y avait aussi ces mères accompagnées de leurs enfants, ou encore ces figures récurrentes qui venaient souvent déposer plainte pour des faits chaque fois nouveaux, souvent confus. D’autres encore me demandaient simplement : « Vous serez là la semaine prochaine ? », comme une reconnaissance muette de l’aide apportée, ce qui valait pour moi bien plus qu’une validation.
Dans les moments creux, je me plongeais dans les classeurs, j’échangeais avec mes camarades, curieuse d’en savoir plus, avide de comprendre mieux. Ce que nous apprenons sur les bancs de la faculté, j’ai pu l’incarner ici. J’avais peur, au début, de ne pas être à la hauteur. De ne pas tout retenir. De ne pas savoir répondre. Et puis j’ai vu que face à une langue perçue comme étrangère par beaucoup, je pouvais être une passeuse, une simplificatrice sans jamais être simpliste. Cette mission m’a appris à expliquer sans infantiliser, à entendre ce qui ne se dit pas. J’ai aussi compris que je n’étais pas là pour tout régler, mais surtout pour éclairer un chemin.
Ce que je retiens, dans l’univers juridique, c’est qu’on ne manie pas que des mots : au-delà des textes, on manipule un peu de dignité, beaucoup d’humanité. Ce que j’ai appris en salle de cours a soudainement pris chair. Pour beaucoup, parfois même pour des enfants, le droit n’était pas seulement un concept, mais un quotidien, souvent rude, parfois injuste, mais que je pouvais contribuer à adoucir. Cette mission a ancré en moi une certitude : celle de continuer à évoluer dans un environnement où je peux aider, traduire, rendre concret ce qui me paraissait si abstrait quand j’ai commencé mes études de droit. Aujourd’hui, je repars grandie. Mettre les pieds dans ce monde, c’était comme entrer dans un lieu que je regardais de loin. Aujourd’hui, j’y avance avec confiance, et avec gratitude.
Il me semble que le dernier mot doit être « merci » — pour avoir vu, dans une simple lettre et un bref échange, assez pour me confier cette mission. C’est ce regard porté sur moi qui m’a permis de faire tout ce chemin.